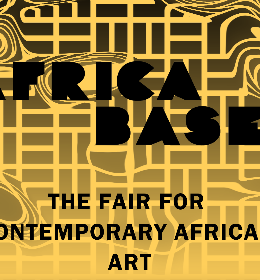Après avoir — longuement — détaillé une série de mesures de soutien à l’industrie culturelle, (l’état finance à 75 % la Biennale) les premiers prix étaient décernés. Seul hic, parmi les 4 artistes (logiquement) récompensés — Arebenor Bassène, Sammy Baloji, Modupeola Fadugba et Youssef Limoud —, un seul était présent. La raison ? « Ils n’ont juste pas été informés à temps. »
Comme l’on dit ici « vous vous avez des montres, nous on a le temps » ; un dicton totalement à propos.
À Dakar, la biennale est davantage présente sur les panneaux d’affichage que dans l’esprit de la population — dont la majorité n’a pas la moindre idée de ce qu’il se passe. A ce sujet le curateur Simon Njami précise dans Jeune Afrique : « Non, je ne veux pas la rendre populaire, je veux la rendre accessible. Je ne peux pas présupposer ce que le peuple veut, mais je veux lui donner l’opportunité d’apprécier. »
Le pari était compliqué, mais il est — bon an, mal an — réussi. Comme Simon Njami l’indiquait au Monde, la possibilité d’investir l’Ancien Tribunal était une prérogative du commissaire ; on le comprend. L’incroyable lieu, situé à Cap Manuel, est un écrin sublime — quoique pas forcément adapté à une exposition de ce type. L’on doit par ailleurs au commissaire la venue d’émissaires de grands musées américains — superbe opportunité pour les artistes présents.
Ici, la star est évidemment Kader Attia. L’artiste nous propose ses Rhizomes infinis de la révolution, message optimiste, présentant les bourgeons d’un avenir meilleur. L’œuvre est réussie, c’est (toujours dans le même style) du Kader Attia.
L’optimisme, le refus de s’apitoyer sur son sort — celui de l’Afrique en particulier —, reprendre confiance, voilà les thèmes autour desquels Simon Njami a construit sa proposition, et, aux côtés des prometteurs bourgeons du plasticien franco-algérien, 66 artistes — dont 25 % de nigérians — sont réunis pour une exposition intitulée « Réenchantement ».
Certes les propositions sont inégales, mais dans ce vaste espace, de belles découvertes.
Ainsi, dans le hall Modupeola Fadugba nous propose de jouer… enfin en apparence. Son jeu de dés géant se penche sur le douloureux sujet de l’éducation (en Afrique), avec en toile de fond, l’enlèvement au Nigeria — pays d’origine de l’artiste — de 276 lycéennes en 2014 par les islamistes de Boko Haram.
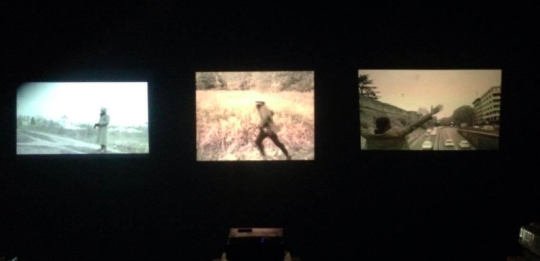
L’artiste du Malawi Samson Kambulu investit quant à lui une salle avec films et photos, Mboya’s American Dispositif and other films, ensemble de scénettes / performances poétiques et absurdes accompagnées d’un mur de portraits de Barack Obama.
Dans un autre registre, les clichés de la jeune photographe — autodidacte — marocaine Safaa Mazirh figurent des corps flous, des images à la fois violentes et mystérieuses, où les corps s’effacent en mouvement. L’artiste égyptien Youssef Limoud — Grand prix Léopold Sédar Sengor — doté de 10 millions de franc CFA, environ 15.000 € —, nous propose quant à lui son Maqam (mausolée d'un saint) fait de terre, bois et divers matériaux de récupération. Le nigérian Victor Ehikhamenor présente lui sa salle de prière (psychédélique), appréciée par les visiteurs (et réseaux sociaux).
En parallèle de l’envoûtante exposition principale, l’ancienne gare ferroviaire de la ville accueille performances et fêtes — où se côtoient journalistes et expat’s…

Toujours à Dakar, Le Manège de l'Institut Français a fait le plein pour accueillir l’hommage à Revue Noire de l’artiste malgache Joel Andrianomearisoa. A travers sa Maison sentimentale l'artiste réalise une fresque revenant sur l'histoire d'une publication avec laquelle il est lié depuis ses 19 ans. Publiée de 1991 à 2001, la revue avait été co-fondée par Simon Simon Njami, et Jean-Loup Pivin. Après Pascale Marthine Tayou, c'est donc au tour de Joel Andrianomearisoa de se preter à l'exercice de l'hommage, proposant une alliance de couvertures marquantes et d'éléments plus personnels. En face, de grands voiles de soie blanche, allégories des futures pages à écrire. Réussi.
En repartant de Dakar, on a envie d’y croire, envie d’être optimiste, le pari Dak’art de Simon Njami est en somme réussi. La force du commissaire réside dans l’alliance de talent et de pragmatisme : une intelligence illustrée par sa réaction sereine lorsqu’on l’interroge sur le choix du pays invité — le Qatar (et le Nigéria) —, décidé par le président Macky Sall. À certains la politique et la diplomatie, à d’autres l’art.
L’évènement, le seul de ce type organisé en Afrique a encore du chemin à faire. Mais il a pris la bonne route, il est réenchanté et réenclenché.